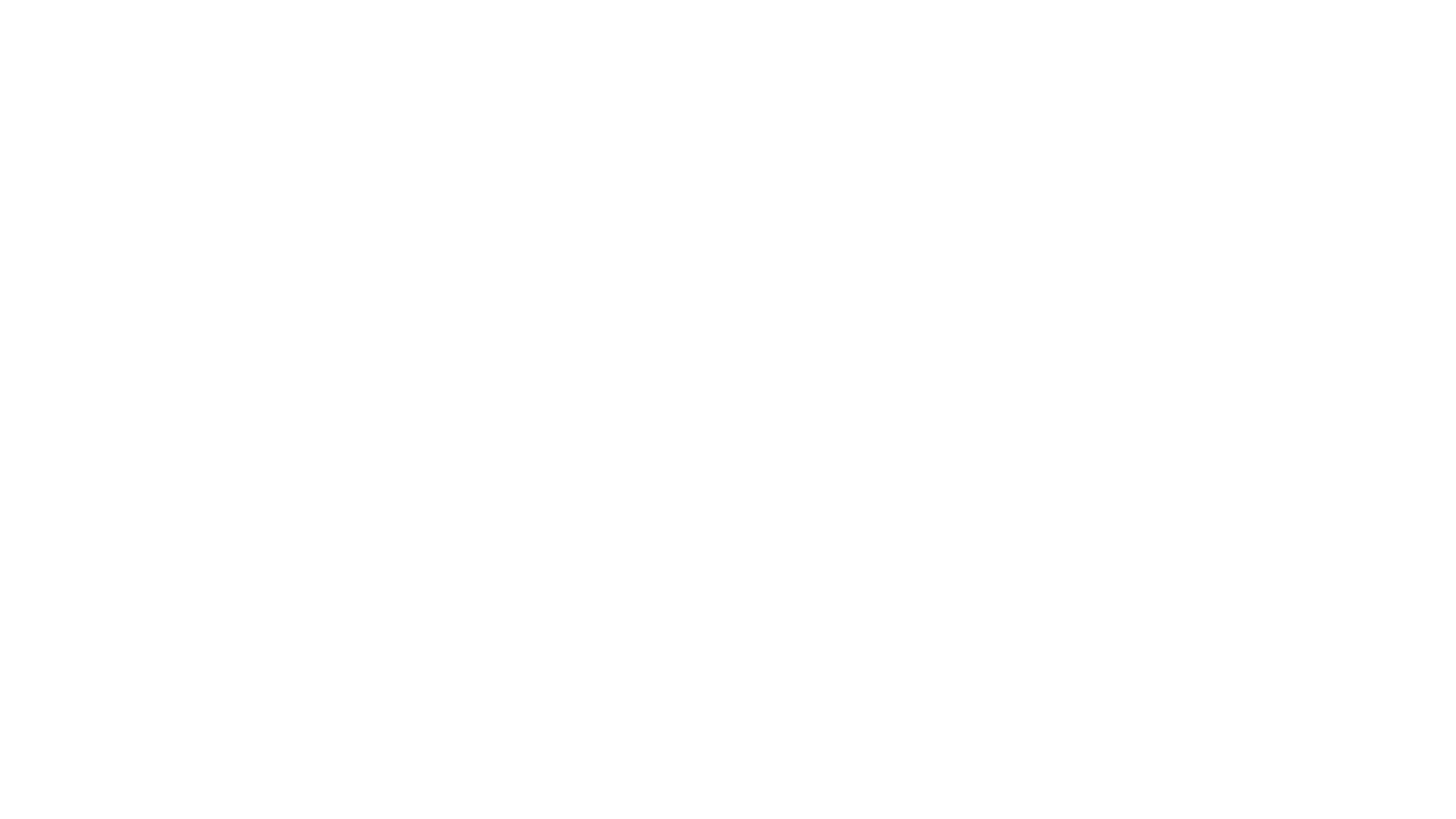Source : AdobeStock
Les voitures modernes sont des monstres de complexité, en raison de leur mécanique sophistiquée, de leurs systèmes automatisés et de leurs innombrables accessoires électriques. Voici un petit survol de quelques-uns des systèmes courants dont l’intervention est souvent mal comprise ou qui causent l’étonnement de la personne au volant.
Le freinage régénératif
Avec l’électrification des motorisations modernes est apparu le freinage régénératif. Cette fonction automatique consiste à utiliser un moteur électrique pour récupérer une partie de l’énergie cinétique de la voiture afin de recharger une batterie d’entraînement. Les freins classiques ne participent généralement au freinage que s’il faut ralentir la voiture rapidement ou pour la maintenir immobile dans une pente.
Cette fonction récupère uniquement une partie de l’énergie dépensée pour accélérer. Quant à l’énergie dépensée pour maintenir la voiture à vitesse constante, elle ne peut être récupérée; elle a servi à combattre la friction mécanique et la traînée aérodynamique. Le freinage régénératif est donc en fonction uniquement à la décélération et au freinage, et lors de la descente d’une pente afin d’empêcher la voiture d’accélérer sous l’effet de la gravité. Son effet est donc nul lors des trajets à vitesse constante sur autoroute, et maximal lors de la conduite en ville avec des arrêts fréquents aux feux rouges.

Précision : le freinage régénératif est désactivé lorsque la batterie est à pleine charge ou lorsque sa température est hors de sa plage normale de fonctionnement. Dans ces cas, ce sont uniquement les freins à friction qui freinent la voiture.
Par ailleurs, sachez que le freinage régénératif accélère l’usure des pneus de l’essieu moteur, mais réduit l’usure des freins classiques. Dans notre climat, cela cause d’ailleurs des soucis de durabilité, car les freins, puisqu’ils servent peu, sont sujets à la corrosion.
Hybride et hybride rechargeable
Contrairement à une croyance populaire, une voiture hybride ordinaire (qui n’a donc pas de port de recharge) n’est pas une voiture électrique. En effet, toute l’énergie qui sert à la propulser provient de l’essence de son réservoir. Le système hybride ne sert qu’à récupérer une partie de l’énergie cinétique à la décélération, et sa batterie est un réservoir temporaire d’énergie électrique qui sera mise à profit lors de la prochaine accélération.
Certaines voitures permettent de recharger la batterie en roulant. Dans ce cas, c’est le moteur à essence qui travaille plus fort pour recharger la batterie tout en assurant le maintien de la vitesse. Il n’y a donc pas de raison de le faire, ni sur le plan énergétique ni sur le plan économique. Le seul intérêt consiste à stocker un peu d’énergie pour rouler en mode électrique par la suite.
Une voiture hybride rechargeable est une voiture électrique à temps partiel, et seule l’énergie électrique stockée lors du branchement à une borne de recharge permet d’économiser de l’essence. Elle peut rouler en mode électrique sur une certaine distance si sa batterie est suffisamment chargée. Toutefois, il ne faut pas s’étonner que le moteur à essence démarre de temps en temps. Celui-ci doit tourner à l’occasion pour faire circuler l’huile et l’essence et pour atteindre sa température normale de fonctionnement. Ces démarrages aléatoires sont nécessaires afin de rendre le moteur à essence apte à prendre le relais de l’électrique lorsque les conditions de circulation l’exigent.

Le réseau électrique multiplexé
Une petite révolution technologique est apparue au milieu des années 90 et elle est passée presque inaperçue. Depuis les tout débuts de l’automobile, le circuit électrique type d’un accessoire électrique était composé de la batterie, de câbles, d’un commutateur et du composant en question. On actionne le commutateur, et le composant se met en marche. Simple comme bonjour. C’était parfait quand les voitures n’avaient que quelques accessoires comme les phares, l’essuie-glace, la radio et le ventilateur de chauffage.
Mais lorsqu’on ajoute quatre glaces à commande électrique, des rétroviseurs chauffants à réglage électrique et des serrures électriques, on constate qu’un faisceau de câblage comme celui de la portière du conducteur doit comporter plusieurs dizaines de fils individuels. Un tel faisceau de câblage est encombrant, coûteux et fragile, puisqu’il doit se plier et se déplier à chaque ouverture de la portière.
La solution est venue du monde de l’informatique : il suffit de créer des zones pour mettre toutes ces fonctions en réseau. On y parvient en intégrant des mini-ordinateurs (appelés boîtiers électroniques de commande) qui supervisent et assurent un grand nombre de fonctions. Une voiture moderne comporte une bonne trentaine de ces boîtiers électroniques. Ils communiquent entre eux grâce à un câblage électrique simplifié commun, et ce n’est plus la totalité de l’énergie électrique qui circule dans ce câblage, mais uniquement un « message » électronique. Le faisceau de câblage s’en trouve grandement simplifié, puisque tous les messages de commande circulent sur un même câblage et ce sont les boîtiers locaux qui actionnent les accessoires.

Toutes ces fonctions automatiques qui vous émerveillent (ou qui vous agacent…) sont le fruit de cette révolution. Pensez au toit ouvrant qui se referme légèrement de luimême à mesure que la vitesse augmente pour éviter un bourdonnement désagréable, à l’essuie-glace arrière qui se met en marche automatiquement au passage de la marche arrière lorsque celui du pare-brise est en fonction, au phare antibrouillard qui s’allume à basse vitesse lorsque le volant est tourné, ou à l’éclairage d’accueil qui s’active au déverrouillage des portières.
Les aides à la conduite classiques
Créé initialement pour usage sur les trains et les avions, le système de freinage antiblocage s’est généralisé sur nos voitures au cours des années 80. Il est obligatoire depuis les années 90. Si son utilité est indiscutable sur chaussée sèche ou mouillée, ce n’est pas le cas sur chaussée enneigée, car il rallonge la distance de freinage. Sa présence est tout de même bénéfique, car ses composants sont à la base de deux autres systèmes : l’antipatinage (souvent mal traduit par « contrôle de traction ») et l’antidérapage (« ESP » ou « contrôle de stabilité »).
L’antipatinage, comme son nom l’indique, intervient lorsqu’une roue patine et tourne plus vite que les autres. Le système applique alors le frein sur cette roue. Cette intervention est souvent mal comprise par la personne au volant, car son action est bruyante et peut inciter à lever le pied pour qu’elle cesse. Pourtant, l’antipatinage aide grandement la voiture à avancer, surtout en montée, car freiner la roue qui patine permet de transférer davantage de couple à l’autre roue. Si celle-ci a un peu d’adhérence sur la chaussée, alors la voiture continue d’avancer pour peu qu’on maintienne l’accélérateur enfoncé.

L’antidérapage va encore plus loin. Un capteur mesure l’angle du volant (donc la trajectoire souhaitée), un autre mesure la trajectoire réelle de la voiture, et si les deux ne concordent pas, alors le système applique le frein sur une ou plusieurs roues afin d’aider la voiture à suivre la route.
Ceux qui en ont fait l’expérience sont souvent impressionnés par l’efficacité du système. C’est presque de la magie. Vous arrivez trop vite dans un virage, vous tournez le volant, et rien ne se passe? L’antidérapage prend le relais en freinant les roues intérieures. Même chose lorsque vous levez le pied en plein virage et que l’arrière veut passer devant. Ce sont alors les roues extérieures qui sont freinées, ce qui ramène la voiture sur la trajectoire tout en la ralentissant. De la magie, je vous dis.
Ces trois aides à la conduite ne permettent évidemment pas de s’affranchir des lois de la physique, et leur efficacité est tributaire de la qualité des pneus.
La climatisation automatique
Votre voiture est équipée de la climatisation régulée dotée d’un mode « Auto » qui souffle une tornade glacée au démarrage? Vous devez souvent jouer avec la vitesse du ventilateur? Changez de stratégie! Aidez-la en sélectionnant une température appropriée à la saison et laissez-la faire son travail.
Par temps chaud, elle est programmée pour souffler de l’air frais à basse vitesse sur les occupants, et surtout pas sur vos pieds chaussés de sandales. Une fois que votre visage et votre torse sont rafraîchis, c’est suffisant; vous vous sentez bien. En hiver, c’est l’inverse : l’air chaud est dirigé vers le plancher et le pare-brise. Tout le monde veut avoir les pieds au chaud et personne n’aime se faire souffler une brise tiède sur le visage.
La solution consiste à laisser le mode Auto activé et à trouver le réglage de température qui rend l’expérience agréable. Il faut également laisser un maximum de buses ouvertes afin que le débit d’air soit bien réparti. C’est que le système est composé de plusieurs capteurs qui tiennent compte de l’ensoleillement et de la température ambiante en plus de la température de l’habitacle. Un algorithme calcule alors le volume d’air requis et sa température et détermine où le diriger.
Les meilleurs systèmes « trichent » un peu avec la température sélectionnée. Par exemple, même si la commande de climatisation affiche une température de 22°C, il se peut que la température de l’habitacle ne soit jamais à 22°C. L’algorithme amène plutôt le système à atteindre un niveau de confort qui convient à la saison, et non à atteindre exactement la température demandée. Son action est invisible, mais elle assure un confort optimal en s’adaptant en permanence aux conditions réelles de l’habitacle.